SONS
Nantes – quai Richebourg, vers 1860
Oh ! ce quai Richebourg, si long, si vide, si triste. […] En face, au loin, des chantiers dépeuplés, où quelques hommes rôdent avec un outil à la main, donnant de temps en temps un coup de marteau qu’on entend à une demi-lieue dans l’air, lugubre comme un coup de cloche d’église.
[…] Oh ! ce silence ! troublé seulement par le bruit d’une conversation entre les mariniers ! ou le ho, ho ! lent de ceux qui tirent sur la corde, dans le chemin de halage, pour remonter un bateau. (Jules Vallès, « Le Bachelier » (1881), Garnier-Flammarion, Paris, 2011.)
Nantes – place Viarme, vers 1920
Une fois par mois, dès le matin, les mugissements et les hennissements secouent le silence habituel du lieu et les longues files de quadrupèdes viennent s’aligner par catégories, sous le fouet des bouviers et des maquignons. (Henri Barbot, « Nantes en flânant », Imprimerie de Lajartre, Nantes, 1930.)
Naples, circa 1920
Si vous croyez qu’à Naples on a le temps de regarder le Vésuve. On est déjà content de sortir sain et sauf, physiquement, du trafic des voitures, des calèches et des motos et nerveusement, du vacarmes des crieurs, des klaxons, du bruyant cliquetis du tram et du cris prolongé des petits vendeurs de journaux. On n’avance pas facilement dans ces conditions.
[…] Les Napolitains ne peuvent concevoir l’existence sans foule grouillante. (Walter Benjamin, « Lumières pour enfants », [trad. Sylvie Muller], in: « Le goût de Naples », Mercure de France, Paris, 2003, p. 34.)
Nantes, 1938
Notre premier contact avec Nantes fut très dur. […] Le simple fait de se repérer, de se retrouver, dans tant de rues et places, lorsqu’on vient d’une petite ville demeurée quasiment villageoise, est déjà paniquant. Mon exil à Nantes signifiait la perte de mon identité rurale et mon entrée douloureuse dans un monde inconnu : celui de l’urbain et du moderne. Par là même je subissais, je participais à la révolution normale de mon siècle. Mais je l’ignorais. Je tirais encore de toutes mes forces pour m’accrocher à la civilisation du cheval et des bœufs. Mais les tramways de Nantes, les sirènes des bateaux dans le port, les sirènes des usines de locomotives des Batignolles, les sirènes de la Sucrerie Say, de la Conserverie Amieux, du chantier naval ; le sifflet de la locomotive qui traversait encore la ville en traînant derrière elle des kyrielles de wagons, les autos, les camions, tout ce tintamarre me disait que j’étais maintenant prisonnier de la ville. (Michel Ragon, « L’accent de ma mère », Albin Michel, Paris, 1980.)
Naples, 2003
Ce qui surprend d’emblée le voyageur, c’est aussi la rumeur persistante de la ville, avec des véhicules de toutes sortes qui traversent la ville de part en part, en klaxonnant sans cesse. Voitures, motos, mobylettes circulent dans conditions ahurissantes pour l’étranger non habitué aux grandes métropoles méditerranéennes : pour la circulation, Naples ressemble au Caire. De plus, à l’approche du port de Mergellina (point de départ du trafic de la baie) s’ajoute à ce tintamarre le vacarme des sirènes des multiples bateaux, hydroglisseurs, ferries et autres embarcations qui sillonnent le port en tous sens.
[…] Le « son » de Naples, c’est aussi la rumeur de la foule, avec cet accent napolitain irrésistible, chantant, un peu traînant, légèrement chuintant. Ce sont les interpellations, sur les marchés, dans les rues, où le passant se fait héler à tout propos, les bribes de chansons qui fusent un peu partout. Un savant crescendo sonore qui culmine régulièrement avec l’explosion des fêtes, toutes les fêtes, religieuses ou franchement païennes, ponctuées par l’explosion de « fuocchi », ces feux d’artifice que la population elle-même tire à toutes occasion : les fêtes religieuses de septembre – la Madone de Piedigrata ou le renouvellement du « miracle de saint janvier », mais aussi les grandes victoires du « calcio » – football – jusqu’aux fêtes de « capo d’anno », à la Saint-Sylvestre. Alors, toute la ville salue le nouvel an dans l’explosion de milliers de pétards et bombes joyeuses, tout en fracassant du haut des fenêtres la veille vaisselle dont on se débarrasse pour faire place à l’année nouvelle. (Pascale Lismonde, « Le goût de Naples », Mercure de France, Paris, 2003, pp. 41 et 43.)
LUMIERES DU NORD
Flandres – Belgique, 1885
Rubens est le seul peintre ayant rendu le ciel de Flandres. Hobbema et Ruysdael sont lourds, lui seul a su trouver ces tons de lumière voilée qui donnent tant de profondeur à ses paysages. (Berthe Morisot, « Carnets », Ed. Samuel Rodary et L’Echoppe, Paris, 2023, p. 13.)
LUMIERES DE VENISE
Venise, 2019
En ce début d’automne l’air est doux, la lumière, comme toujours ici, sensuelle et indéfinissable, une brillance si délicate et charnelle que, pour s’en tirer d’affaire, on ne peut que s’en rapporter aux couleurs des grands peintres de Venise, en particulier Véronèse. (Jean-Paul Kauffmann, « Venise à double tour », Equateurs, Paris, 2019, p. 42.)
Venise, 1895
Comme tous les pays lumineux, [la ville] est d’un coloris gris, l’atmosphère en est douce et brumeuse et le ciel s’y pare de nuages tout comme un ciel de nos contrées normandes ou hollandaises. […] Ca ne se dore pas, ça s’argente plutôt. (Eugène Boudin, cité dans notice de son tableau « Venise, vue prise de San Giorgio« , exposé dans l’exposition « Eugène Boudin », Musée Marmottant, Paris, 2025.)
TOUCHER DES SOLS
Strasbourg, 1838
Son pavé de cailloux est bien plus rude et plus raboteux encore que l’inégal pavé du Mans. […] La rue Brûlée et la rue du Dôme, à l’heure qu’il est, on l’a pavée en asphalte. […] Le bitume envahit peu à peu Strasbourg, et ce n’est pas malheureux, vu l’imperfection du pavage actuel ; dans une ville pavée en cailloux, le bitume est roi. (Gérard de Nerval, « Strasbourg », publié dans le Messager du 18 octobre 1838, in: « Oeuvres tome II », Bibliothèque nrf de la Pléiade, Paris, 1956, p.743 & 748.)
ODEURS
Norvège – Hjerkinn (Jerkin à l’époque), 1820
Lorsque j’entrai à Jerkin dans la petite chambre qu’on me donna, je fus agréablement surpris d’y trouver tout propre et bien rangé. Le plancher, comme c’est la coutume en Norvège, était jonché de rameaux de genévrier qui répandait une délicieuse odeur et sollicitaient presqu’invinciblement au repos. (Capell Brooke, « Voyage en Suède, en Norvège, au Finnmark et au cap nord. – relation d’un hiver en Laponie, en Suède et au Finmark », in: « Voyages en Europe » / par Walsh, Thomas et Lyall, Quin… [et al.] , revus et traduits par M. Albert de Montemont, chez Bry Ainé, éditeur, Paris, 1855, p. 15.)
Londres, 1852
A l’est, ou dans la Cité, le trafic règne en des avenue étroites, étouffées, que tapissent une boue épaisse et noire, d’où s’exhalent des miasmes que l’indigène de Londres, si dédaigneux dans ses voyages à l’étranger, supporte sans murmure. On respire surtout ces mauvaises odeurs auprès de Wapping, quartier des matelots, des cordiers, des escrocs et des mendiants ; ou de Smithfield, grande place où se tient le marché des bestiaux. (Albert-Montemont, « Voyage en Angleterre », in: « Voyages en Europe » / par Walsh, Thomas et Lyall, Quin… [et al.] , chez Bry Ainé, éditeur, Paris, 1855, p. 8.)
Madrid, vers 1905
Mes plus lointains souvenirs d’enfance m’encerclent d’un doux rêve ombragé: d’après-midi finissantes où je m’enivrais jusqu’à la douleur des odeurs madrilènes de l’acacia, des troènes et de la terre humide. (José Bergamín, « Souvenirs inédits », in: « Cahiers pour un temps », Ed. du Centre Georges Pompidou, [trad. Eric Beaumartin].
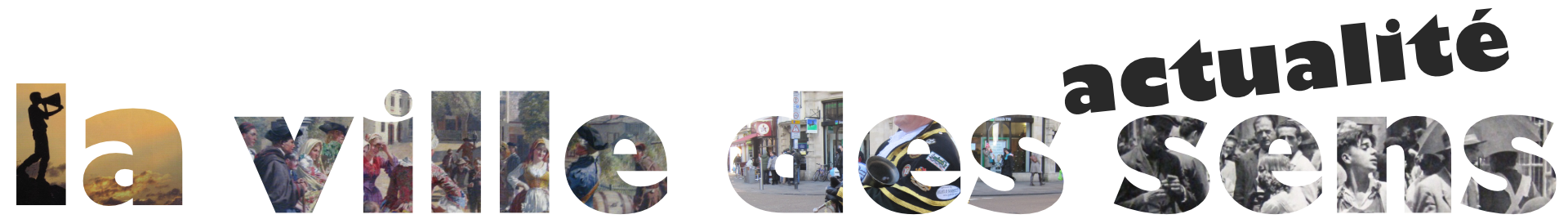
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.