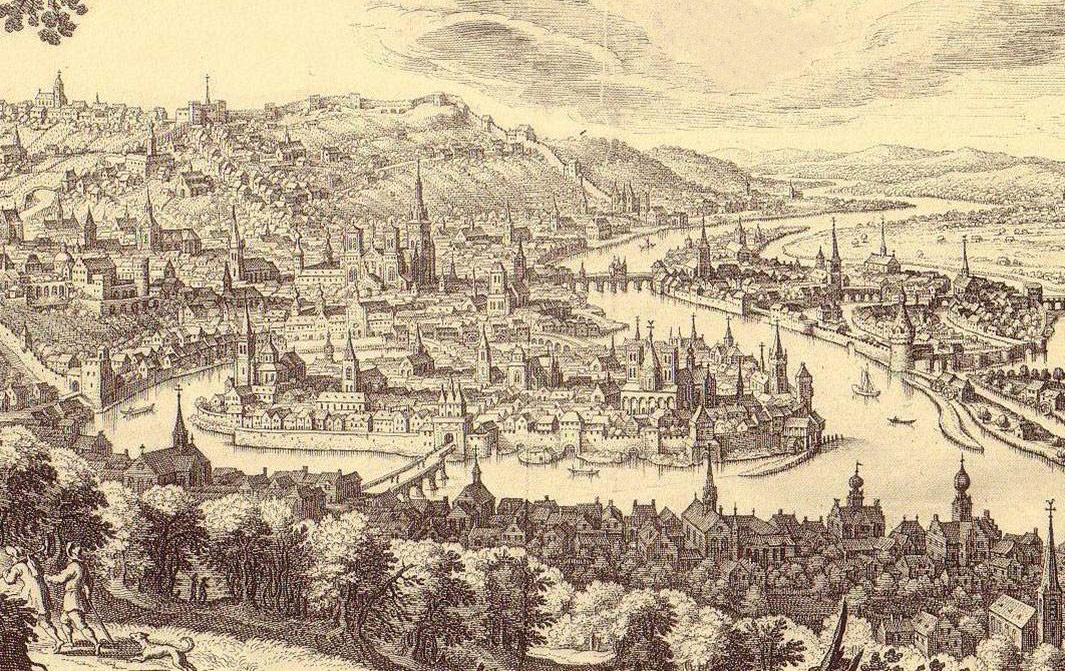l’odeur des villes au XVIIIè s
Chaque jardin possédait un coin pour la culture des roseaux qui poussait sur sol sec. On les vendait en grande quantité. Ils étaient répandus par terre non seulement dans les chambres à coucher, mais même dans la salle à manger et sur la scène des théâtres. (...)
Les Elisabéthains mettaient des roseaux neufs sur les vieux, et les pièces n'étaient débarrassées de leurs joncs qu'une fois l'an.
(Léon Lemonnier, "La vie quotidienne en Angleterre sous Elisabeth", Hachette, paris, 1950, p. 19.)
Venise – 1728
Il est impossible que les tableaux se conservent dans les églises : 1° l’humidité ; 2° les cadavres qu’on y enterre, qui gâtent tout par les esprits de la graisse qui en sortent.
(Montesquieu, "Voyages de Montesquieu", Stock, Paris, 1943, p. 17)
Paris – juillet 1731
Combien l'abord de Paris démentit l'idée que j'en avais! […] En entrant par le faubourg Saint-Marceau je ne vis que de petites rues sales et puantes, de vilaines maisons noires, l'air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, des charretiers, des ravaudeuses, des crieuses de tisanes et de vieux chapeaux. Tout cela me frappa d'abord à tel point que tout ce que j'ai vu depuis à Paris de magnificence réelle n'a pu détruire cette première impression, et qu'il m'en est resté toujours un secret dégoût pour l'habitation de cette capitale
(Jean-Jacques Rousseau, ″Les confessions – livre quatrième, Editions Baudelaire, Paris, 1966, p. 156).
Venise – août 1737
Le canaux, malgré leurs agréments, ont une chose intolérable. Le flux et le reflux se fait sentir où nous sommes dans le fond du golfe, et quand la mer est basse, en été, les canaux étroits sont d’une horrible infection. On sait bien qu’il faut que les choses sentent ce qu’elles doivent sentir : il est permis aux canaux, quels qu’ils soient, de puotter en été ; mais pour le coup, c’est abuser de la permission.
(Président de Brosses, Lettre XVI, "Lettres d’Italie", Mercure de France, Paris, 1986, p. 237)
Hyères - 1740
Nous apprîmes à Hyères, car on s'instruit en voyageant, l'effet que produisent dans l'air les caresses du dieu des Zéphirs et de la déesse des Jardins. Vous savez, Madame, qu'en approchant du pays des orangers, on respire de loin le parfum que répand la fleur de ces arbres. Un cartésien attribuerait peut être cette vapeur odoriférante au ressort de l'air; un newtonien ne manquerait pas d'en faire honneur à l'attraction. Ce n'est rien de tout cela.
Quand par la fraîcheur du matin
La jeune Flore réveillée
Reçoit Zéphire sur son sein,
Sous les branches et la feuillée
De l'oranger et du jasmin,
Mille roses s'épanouissent;
Les gazons plus frais reverdissent,
Tout se ranime, et chaque fleur,
Par ces tendres amants foulée,
De sa tige renouvelée,
Exhale une plus douce odeur.
Autour d'eux voltigent avec grâce
Un essaim de zéphirs légers;
Mais ce qui plus nous étonna,
C'est qu'on y voit les étrivières
Dont il châtia les rivières
Quand Garonne se révolta:
Fait que l'on ne connaissait guère
Lorsque Chapelle l'attesta.
[…] Le jour suivant nous fûmes nous rassasier du coup d'oeil ravissant des côtes d'Hyères. Il n'est point de climat plus riant, ni de terroir plus fécond. Ce ne sont partout que des citronniers et des orangers en pleine terre.
Le grand enclos des Hespérides
Présentait moins de pommes d'or
Aux regards des larrons avides
De leur éblouissant trésor.
L'Amour les suit et s'embarrasse
Dans les feuilles des orangers.
Zéphire, d'une âme enflammée,
Couvre son amante pâmée
De ses baisers audacieux,
Leur couche en est plus parfumée;
Et dans cet instant précieux,
Toute la plaine est embaumée
De leurs transports délicieux.
Le lever de l'aurore et le coucher du soleil sont ordinairement accompagnés de ces douces exhalaisons. Les jardins d'Hyères ne sont pas moins utiles qu'agréables. Il y en a un, entre autres, qu'on dit valoir communément en fleurs et en fruits jusqu'à vingt mille livres de rente, pourvu que les brouillards ne s'en mêlent pas.
(Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, "Voyage de Languedoc et de Provence", in "Œuvres complètes", Paris, 1784, in: Jean M. Goulemot, Paul Lidsky et Didier Masseau, "Le voyage en France – anthologie des voyageurs européens en France, du Moyen Age à la fin de l'Empire", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1995, pp. 727-728.)
Toulon – vers 1748
A l’abri des maisons et de l’Arsenal, le mistral ne suffisait plus pour dissiper l’odeur des galères qui empestaient toujours le matin, surtout en hiver où l’immense toile d’herbage tendue au-dessus du bâtiment, enveloppait avec la chaleur des corps les miasmes des ordures, de la transpiration et des déjections. On venait respirer là la puanteur formidable de la déchéance humaine auprès de laquelle le fumier des rues paraissait dérisoire. (…) Cette puanteur poussée par un vent du sud avait précédé l’arrivée de la première galère dans le port de Toulon. Une foule énorme, plus de la moitié de la ville avait-on dit, attendait le bâtiment, installée sur les quais, les digues et les remparts, entassée à bord d’embarcations de toutes tailles, (…) D’ordinaire, ce vent du sud drainait des odeurs d’iode et celle des pins du cap Cepet pour embaumer la ville, mais cet après-midi-là, il parut se charger de toute la pourriture infecte de la galère, pour la répandre, en guise d’avertissement, sur les milliers de Toulonnais présents.
(G. J. Arnaud, “Crâne d’argent“, Julliard, Paris, 1992, cité in : “Var“, Guides Gallimard, Paris, 1993, p. 106.)
Madrid – 1755
Madrid est belle, riche, florissante et peuplée, et bien qu’elle ne soit pas située en plaine, ses rues sont droites, ses places sont grandes et ses maisons hautes. Elle est pleine de la majesté de ses églises, l’abondance règne dans ses palais, la magnificence de la cour, la splendeur dans le peuple. […] Enfin, ce qui attire l’attention, ce sont surtout la grandeur, l’abondance et le luxe. Et si en quelque endroit on voit une image de pauvreté et de misère, elle se trouve aussitôt compensée par cette noblesse majestueuse, qui aussi maigre soit-elle, tremblante et dépenaillée, rayonne toujours. Mais quoi donc ? Tout est sale, tout est répugnant, tout sent mauvais! En quelque lieu que l’on se trouve, dans une maison ou sur une place, à l’ombre ou au soleil, dans une diligence ou à pied dans la rue, il semble toujours que l’on soit dans un égout. Qui va sous la chaleur accablante de par la ville, est continuellement enveloppé d’un nuage de poussière et contraint à son corps défendant de l’avaler, de s’en nourrir le jour à en être repu le soir : je vous en parle d’expérience. Point n’est besoin ici de parfums, ni celui que l’on nomme Regina, di de Melisse; ni de Sans-pareille, ni de toutes ces essences florentines, ni de tous ces parfums arabes : et nos Dames lombardes avec tous leurs parfums, leurs baumes et tous les moyens qu’elles pourraient imaginer, ne parviendraient pas à s’abriter de cette puanteur tenace, que l’on respire tout le temps. On ne peut que vivre avec elle, la souffrir…
(Norberto Caimo, "Lettre d’un viaggiatore italiano ad suo amico", Lucques, 1759, in : Giuliano Briganti, "Peintres de Vedute", Electa France, Paris, 1971, p. 145.)
Versailles - 1764
Le parc, les jardins, le château même font soulever le coeur par les mauvaises odeurs. Les passages de communication, les cours, les bâtiments en ailes, les corridors sont remplis d’urine et de matières fécales; au pied même de l’aile des ministres, un charcutier saigne et grille ses porcs tous les matins; l’avenue de Saint-Cloud est couverte d’eau croupissante et de chats morts.
(La Morandière (1764), cité par le Dr Cabanès, “Moeurs intimes du passé”, première série, chap. La propreté de la maison, Albin Michel, Paris, 1958, pp. 382-383.)
Versailles - diverses époques
On admet volontiers que nos aïeux, dans leurs maisons, palais et châteaux, n’avaient aucune de ces commodités dont aujourd’hui on ne saurait se passer (dans les villes du Nord au moins); et, de ce qu’à Versailles les seigneurs de la cour de Louis XIV se trouvaient dans le nécessité de se mettre à leur aise dans les corridors faute de cabinets. [...] Cette négligence à satisfaire aux nécessités de notre nature physique était poussée très loin dans le temps où l’on songeait surtout à faire de l’architecture noble. Non seulement le château de Versailles, où résidait la cour pendant le XVIIIè siècle ne renfermait qu’un nombre tellement restreint de privés, que tous les personnages de la cour devaient avoir des chaises percées dans leurs garde-robes; mais des palais beaucoup moins vastes n’en possédaient point. Il n’y a pas fort longtemps que tous les appartements des Tuileries étaient dépourvus de cabinets, si bien qu’il fallait chaque matin faire faire une vidange générale par un personnel ad hoc. Nous nous souvenons de l’odeur qui était répandue, du temps de Louis XVIII, dans les corridors de Saint-Cloud, car les traditions de Versailles s’y étaient conservées scrupuleusement. Ce fait, relatif à Versailles, n’est point exagéré. Un jour que nous visitions, étant très jeune, ce palais avec une respectable dame de la cour de Louis XV, passant dans un couloir empesté, elle ne put retenir cette exclamation de regret: “Cette odeur me rappelle un bien beau temps! ”.
(Viollet-le-Duc, ”Dictionnaire raisonné de l’architecture Française du XIè au XVIè siècles”, tome VI, article: latrines, Librairie centrale d’art et d’architecture, Paris, 1853 et suiv., pp. 163-164.)
Paris – 1768
Vous avez, dans Paris, un Hôtel-Dieu où règne une contagion éternelle, où les malades, entassés les uns sur les autres, se donnent réciproquement la peste et la mort.
Vous avez des boucheries dans de petites rues sans issue qui répandent en été une odeur cadavéreuse capable d’empoisonner tout un quartier. Les exhalaisons des morts tuent les vivants dans vos églises et les charniers des Innocents sont encore un témoignage de barbarie qui nous met fort au-dessous des Hottentots et des nègres.
(Voltaire, lettre du 2 avril 1768 au docteur Paulet, in : "Correspondance", édit. Beuchot, t. LVX, p. 70. cité dans : Docteur Cabanès, "Mœurs intimes au passé" (1908), Editions Albin Michel, Paris, 1958, pp. 461, 462.)
Provence – 1773
La vraie Provence, couverte de vignes, d’oliviers innombrables et couverts d’olives comme on a rarement vû, beaucoup d’herbes aromatiques, quelques orangers en plein vent, lauriers, grenadiers dans les hayes. Tout cela représente un bon pays et riche, mais très peu agréable par le trop de montagnes et la malpropreté des villes, pleines de fumier, et rendant autant de mauvaises odeurs que les chemins en rendent de bonnes par les différentes herbes odoriférantes.
(Bergeret de Grancourt, "Voyage d’Italie 1773-1774", Editions Michel de Romilly, Paris, 1948, pp. 25-26) [orthographe oririnale]
Amsterdam – 1774
Amsterdam est une ville infecte. Je ne sais de quels moyens les habitants se sont servis pour en purifier l’air, mais je crois qu’ils se seraient épargné une bonne partie des quarante à cinquante millions qu’ils y ont inutilement dépensés, s’ils avaient pensé à tenir les rues plus larges, à les laver deux fois par jour avec des pompes, à donner plus de profondeur aux canaux, et à défendre expressément d’y laver le linge et d’y jeter aucune immondice.
(Denis Diderot, "Voyage en Hollande", François Maspero, Paris, 1982, p. 143)
Théâtre Naples – 1776
Il y a communément à Naples quatre spectacles ouverts toute l'année, excepté pendant le carême. Le grand opéra ne dure que quelques mois, attendu qu'il ne s'ouvre que vers la fin du mois de mai. Ces quatre spectacles sont le grand opéra, représenté au théâtre dé Saint Charles, qui fait partie du palais du roi, le Théâtre Neuf où se donnent des comédies et de petits opéras dans le goût de nos bûcherons, serruriers, tonneliers, etc., excepté que tout y est en musique et que le récitatif tient lieu chez eux de notre prose. Le théâtre appelé Salle des Florentins dans lequel on représente à peu près les mêmes choses, et le Petit Saint-Charles où se donnent des farces pareilles à celles de Nicolet.
Ces trois derniers sont peu de chose. Les salles sont petites, mal décorées; les loges vilaines les corridors étroits, mal éclairés et pleins d'ordures, étant reçu à Naples de n'aller que dans la partie du corridor qui tient à votre loge pour tous les besoins de la nature.
(Donatien Alphonse François, marquis de Sade, "Voyage d'Italie", œuvres complètes, tome VII, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1965, cité in: Yves Hersant, "Italies – anthologie des voyageurs français aux XVIIIè et XIXè siècles", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1988, p. 576.) (et dans ″Voyage à Naples″, Editions Payot & Rivages, coll. Rivages poche – Petite Bibliothèque, Paris, 2008, p. 42)
Lisbonne, juillet 1777
On m'a assuré que depuis vingt-trois ans on n'avait pas eu à Lisbonne de chaleurs aussi fortes. J'attendais les nuits avec impatience pour jouir de la fraîcheur agréable de l'air, dont on profiterait avec plus de plaisir encore si la malpropreté des habitants n'en altérait la pureté. Dès qu'il est nuit, les rues sont remplies d'ordures, d'animaux morts, et particulièrement de chiens, dont les cadavres jonchent, par milliers, les rues de Lisbonne ; mais à peine est-il huit heures du matin, que déjà la force du soleil a dévoré ces objets de dégoûts qui, sans cela, infecteraient encore toute la ville et y causeraient indubitablement la peste.
(Pierre Dezoteux, baron de Cormatin, "Voyage du Duc de Châtelet au Portugal", F. Buisson, Paris, An VI, 1798, in: "Voyages au Portugal aux XVIIIè et XIXè siècles", Pimientos, Lisbonne, 2005, pp. 113-114)
Lisbonne, 1780
Lord Freeman observa avec justesse que chaque coup d'oeil, à quelque distance de l'endroit où nous étions, était aussi beau que la place que nous occupions était sale et dégoûtante. Il est vrai que les rues ne sont jamais nettoyées, quoiqu'il y ait un marché fait avec des éboueurs; mais ils ne font pas leur devoir. On jette la nuit, et même pendant le jour, toutes sortes d'ordures des maisons dans les rues, qui seraient encore bien plus malpropres qu'elles ne le sont, si tout ce qui peut se manger n'était pas dévoré promptement par des milliers de chiens qui vivent dehors, et n'appartiennent à personne; et comme les rues sont plus droites et plus larges depuis le tremblement de terre [de 1755], les rayons du soleil qu plongent détruisent les exhalaisons pestilentielles, purifient l'air, et rendent ces rues plus propres qu'elles n'étaient auparavant. Un vent frais du nord qui s'élève sur le midi, rafraîchit les habitants brûlés par le soleil, au moins dans les parties hautes de la ville, et emporte l'air malsain. Il est cependant impossible d'aller dans les rues, sans que les nerfs olfactoires [sic] ne soient à chaque moment salués par les plus désagréables sensations.
(James Ferrier, "Lettres sur le gouvernement, les moeurs et les usages en Portugal", lib. Pitou, Paris, 1810, in: "Voyages au Portugal aux XVIIIè et XIXè siècles", Pimientos, Lisbonne, 2005, p. 97)
Grasse – 1780
La ville est entourée, au midi, de prairies, et surtout de jardins ornés de toutes sortes de fleurs que les eaux jaillissantes de la montagne animent et vivifient. Les orangers, les citronniers et les cédrats mêlés au jasmin d’Espagne, répandent, quand ils sont en fleurs, un parfum délicieux. […] Malgré la beauté du climat et la pureté de l’air, la ville de Grasse n’est pas jolie. Les rues y sont étroites et irrégulières, sans ornements, et toujours couvertes de fumier, comme le sont celles de beaucoup de villes et de tous les villages de Provence. Cependant, elle est assez commerçante. On y fabrique des cuirs tannés avec de la poudre de lentisque qui les rend verts et de meilleur usage que le cuir rouge. […] La soie fournit une seconde branche de commerce. La troisième est celle des fabriques de cire, de pommades, d’essences, de savonnettes et de parfums connus dans tout le royaume.
(Abbé Jean-Pierre Papon, ”Voyage de Provence”, La Découverte, Paris, 1984, p. 210.)
Nice – 1780
Après avoir passé le Var, on entre dans le terroir de Nice, borné au midi par la mer et au nord par les hautes montagnes des Alpes, qui le mettent à l’abri du froid aquilon, et sur lesquelles la nature déploie un caractère si fier et si imposant. En hiver, lorsque l’aride sommet de ces montagnes est caché sous des tas énormes de neige, c’est un spectacle bien frappant de voir à leur pied la nature se couronner de fleurs et même de fruits, sur cette verdure éternelle dont les jardins sont émaillés. C’est au mois d’avril surtout qu’elle paraît dans toute sa beauté ; la vigne et l’oranger exhalent une odeur qui, se mêlant à celle de l’œillet, de la rose et du jasmin, parfume l’air d’alentour.
(Abbé Jean-Pierre Papon, ”Voyage de Provence”, La Découverte, Paris, 1984, p. 222.)
Paris – 1782
L’odeur cadavéreuse se fait sentir dans presque toutes les églises ; de là l’éloignement de beaucoup de personnes qui ne veulent plus y mettre les pieds. Le vœu des citoyens, les arrêts du Parlement, les réclamations, tout a été inutile : les exhalaisons sépulcrales continuent à empoisonner les fidèles.
(Louis Sebastien Mercier, "Tableau de Paris", tome 1, "art. "L’air vicié", (1782), Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1990, p. 49.)
Lisbonne, 10 novembre 1786
Le quartier nommé le Bairro Alto, quartier élevé; l'air y est bon et l'on n'y a pas l'odeur de la vase lorsque la marée se retire, odeur d'autant plus insupportable à Boavista où la maison que j'occupe est située, que c'est dans ce local où l'on apporte les immondices de la ville.
Les lieux d'aisance sont encore peu communs dans les maisons portugaises; pour parvenir à leur défaut, on a un grand pot ou deux au plus qui servent à toute la famille. Lorsque la mesure est comblée, les plus soigneux les envoient jeter au bord du Tage, les autres se contentent de les précipiter du haut des étages dans la rue où comme à Marseille et pire encore on court à dix heures du soir le risque d'être assommé, estropié ou au moins abîmé d'ordures.
(Marquis de Bombelles, "Journal d'un ambassadeur de France au Portugal, 1786-1788", P.U.F., Paris, 1979, in: "Voyages au Portugal aux XVIIIè et XIXè siècles", Pimientos, Lisbonne, 2005, p. 124)
Lisbonne
si la malpropreté des habitants n'altérait la pureté. Dès qu'il est nuit, les rues sont remplies d'ordures, d'animaux morts, et particulièrement de chiens, dont les cadavres jonchent, par milliers, les rues de Lisbonne; mais à peine est-il huit heures du matin, que déjà la force du soleil a dévoré ces objets de dégoûts qui, sans cela, infecteraient encore toute la ville et y causeraient indubitablement la peste.
Lisbonne – palais Marialva – 27 juin 1787
La pluie tombant avec violence, on avait fermé toutes les fenêtres ; le jardin ne pouvait nous offrir ces délicates effluves que dégagent les plantes après une ondée; au lieu de quoi on nous fit respirer l’odeur de lavande brûlée.
(William Beckford, “Journal intime au Portugal et en Espagne, 1787-1788 “, Librairie José Corti, Paris, 1986, p. 107.) [traduction Roger Kann]
Lisbonne – juillet 1787
La chaleur et l’odeur de vase règnent dans Lisbonne.
(William Beckford, “Journal intime au Portugal et en Espagne, 1787-1788 “, Librairie José Corti, Paris, 1986, p.141. [traduction Roger Kann]. [dans l’introduction, p. 17, Roger Kann précise que Beckford est incommodé par l’odeur de vase dégagée par le Tage et par la puanteur des monceaux d’immondices dans les rues].
Clermont-Ferrand - 1787
Quelle est ma surprise, quand entrant à Clermont, je ne vois plus que des rues étroites et tortueuses, un pavé détestable, enfin une ville antique, mal bâtie et plus mal tenue encore ... [malgré la pente], par défaut de police, les rues sont presque continuellement si sales et si boueuses que, pendant les deux tiers de l’année, tous les habitants, jusqu’aux gens que jadis on plaçait dans la première classe, portent des sabots par-dessus leurs souliers. Dans les quartiers moins fréquentés, ce sont des amas de fumiers, des immondices de boucheries, des ordures de toute espèce; enfin des vidanges plus dégoûtantes encore, parce que là un grand nombre de maisons n’a point de latrines.
(Legrand d’Aussi, “Voyage fait en Auvergne en 1787 et 1788”, Paris, an III, p. 110 & 137., in: Arthur Young, “Voyages en France”, Armand Colin, Paris, 1976, note p. 383.)
Manosque - 1787
On a ouvert à Manosque plusieurs mines de charbon de terre. Le minéral qu'on en tire se décompose facilement à l'air, laisse voir du cristal de vitriol martial, d'alun et de sélénite. Il répand une odeur de soufre très marquée.
(Jean-Pierre Papon, "Voyage en Provence" (1787), in: Jean M. Goulemot, Paul Lidsky et Didier Masseau, "Le voyage en France – anthologie des voyageurs européens en France, du Moyen Age à la fin de l'Empire", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1995, p. 610)
Manosque - 1787
On a ouvert à Manosque plusieurs mines de charbon de terre. Le minéral qu'on en tire se décompose facilement à l'air, laisse voir du cristal de vitriol martial, d'alun et de sélénite. Il répand une odeur de soufre très marquée.
(Jean-Pierre Papon, "Voyage en Provence" (1787), cité dans: Jean M. Goulemot, Paul Lidsky et Didier Masseau, "Le voyage en France – anthologie des voyageurs européens en France, du Moyen Age à la fin de l'Empire", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1995, p. 610)
Clermont-Ferrand - 1789
Clermont est au milieu d’un curieux pays, entièrement volcanique; il est construit et pavé avec de la lave; la plus grande partie de la ville forme l’un des endroits les plus mal bâtis, les plus sales et les plus puants que j’aie vus. Il y a beaucoup de rues qui, pour la noirceur, la saleté et les mauvaises odeurs, ne peuvent être comparées qu’à d’étroits canaux, percés dans un sombre fumier. L’accumulation des odeurs nauséabondes, dont l’air est imprégné, quand la brise vivifiante des montagnes ne ventile pas ces ruelles remplies d’excréments, me fait envier les nerfs de ces braves gens, qui, autant que je puis savoir, semblent heureux.
(Arthur Young, “Voyages en France 1789”, tome I, Armand Colin, Paris, 1976, pp. 382-383.)
L’Isle-sur-la-Sorgue (arr. d’Avignon) - 1789
L’Isle est très agréablement situé. Avant d’entrer dans la ville, j’ai trouvé de belles plantations d’ormes, avec de chaque côté, de délicieux ruisseaux, murmurant sur les cailloux; des gens bien habillés jouissaient de la douceur du soir un endroit que j’imaginais n’être qu’un village de montagne. C’était pour moi un une sorte de tableau féerique. Et maintenant, pensais-je, combien il est détestable de quitter ce beau bois et cette eau pour entrer dans une ville laide, misérable, entourée d’étroites murailles, chaude et puante; l’un des contrastes qui offusquent le plus mes sentiments.
(Arthur Young, “Voyages en France 1789”, tome I, Armand Colin, Paris, 1976, p. 411.)
Paris – avril 1790
Montez sur les terrasses [des Tuileries] et regardez autour de vous: voyez ces palais et ces hôtels, ces temples, ces quais, ces ponts en pierre de taille, ces voitures qui circulent, cette cohue qui mugit comme un flot toujours montant, et parlez-moi de Paris ! N’est-ce point là une ville unique, la première ville de l’univers, la capitale du luxe et de l’opulence ?
Eh bien, si vous ne voulez pas être détrompé, n’allez pas plus loin. Ailleurs, que verriez-vous ? Des rues étroites, une confusion choquante de richesse et de profonde misère, un tas de harengs et de pommes à moitié pourries à coté d’un brillant magasin de bijouterie ; partout de la boue et même du sang ruisselant de quelque étal de boucher : vous serez forcé de fermer les yeux et de vous tenir le nez. Toutes les splendeurs s’évanouiront devant vous, et vous serez porté à croire que les égouts de toutes les villes du globe viennent déverser à Paris leurs immondices les plus dégoûtantes. Faites un pas de plus, et vous croirez être au sein de l’Arabie Heureuse ou dans les prairies embaumées de la Provence: c’est que vous vous serez trouvé en face d’un de ces nombreux magasins où se débitent des essences et des senteurs. Bref, Paris change d’atmosphère comme d’aspect, en sorte qu’on pourrait dire que c’est la ville la plus belle et la plus hideuse, la mieux parfumée et la plus puante en même temps. Les rues sont en général étroites et sombres, à cause de la hauteur démesurée des maisons. La célèbre drue Saint-Honoré est la plus longue, la plus bruyante et la plus sale de toutes.
(Nicolaï Karamzine, "Lettres d’un voyageur russe", Quai Voltaire, Paris, 1991, pp. 129-130)
Ostende – 21 juin 1790
Me voici débarqué en Flandre, asphyxié par le tabac, à demi empoisonné par l’ail.
(William Beckford, ″Voyage d’un rêveur éveillé de Londres à Venise″, José Corti, Paris, 1988, p. 35)
La Haye – 30 juin 1790
Je me laisse conduire aux tristes et pompeux parterres du greffier Fagel. D’un côté embaumaient toutes les fleurs que la richesse permet d’acquérir; de l’autre s’exhalait toute la puanteur que peut produire un canal. Ces eaux stagnantes défient la toute puissance des Provinces-Unies; elles conservent la liberté de puer en dépit de tous les efforts du gouvernement. Après tout mes affirmations sont peut-être trop osées; je ne dispose d’aucune information susceptible de soutenir mes tentatives pour purifier ces canaux malfaisants. Qui sait si leur odeur ne s’accorde pas avec le naturel d’un Hollandais ? On pourrait se montrer enclin à la croire en voyant les nombreuses salles de banquets et maisons de plaisir reflétant leurs façades à la surface des eaux; elles paraissent placées exprès pour en savoureux les odeurs.
(William Beckford, ″Voyage d’un rêveur éveillé de Londres à Venise″, José Corti, Paris, 1988, pp. 64-65)
Bruxelles – 1793
Les soussignés du quartier de la ruë des Reverends Peres Minimes, ainsi que de la rue haute et de la rue de Christine, exposent très humblement.
Que les immondices, excremens et les eaux de l'hopital militaire du couvent des dits R.R. P.P. minimes de dechargent par un conduit souterain jusqu'aux escaliers de la brafserie des minimes en face de l'autre coté de la ruë, en face dudit hospital.
Que ces excremens parvenus à ces escaliers, sont a decouvert le long des maisons jusqu'à la haute ruë ou ils se dechargent par la grile de l'acqueduc de la Ville, qui se trouve à la maison de Monsieur Selliers.
Que les vapeurs pestilentielles infectent tous les habitans et ceux qui avoisinnent, au point qu'ils sont exposés à des vomifsemens chaque fois qu'ils sont obligés de sortir de chez eux, outre les maladies que peuvent occasionner ces exalaisons infectés d'un hopital aufsi considerable.
Qu'ils se sont addrefsés au corps de genie militaire qui en ont fait la visite et reconnus la necefsité de faire écouler ce conduit par defsous terre, mais que cet ouvrage regardoit la ville.
(plainte formulée en décembre 1793, archives de la Ville de Bruxelles – exposée au musée des égouts)
Lisbonne, 1796
Une fumée grasse, puante, épaisse s'échappe lentement du dessous d'une porte, elle s'élève avec encore plus de lenteur; elle dérobe aux yeux une portion de l'édifice devant lequel elle monte et s'étend. Une foule d'individus des deux sexes en obstrue l'avenue; j'y vois beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvement; j'entends ces cris confus et croisés; je crois qu'il y a un incendie. J'approche, je perce les flots de peuple; je vois un fourneau, un grill, un poêle, un homme graisseux et enfumé. On y fait frire et griller des sardines: la foule attend qu'elles soient cuites pour en prendre chacun sa part. C'est ce qu'on appelle des boutiques de frigideiros. Ce sont des boutiques ambulantes qu'on trouve partout à Lisbonne, dans les rues, sur les places, sous les portes, principalement sous celles des tavernes. On y fait frire et griller, à toutes heures de la journée, surtout à celles des repas, des sardines, des merlans et quelques autres poissons les plus ordinaires.
(Joseph Carrère, "Voyage au Portugal et particulièrement à Lisbonne, ou Tableau moral, civil, politique et religieux de cette capitale", lib. Deterville, Paris, 1798, in: "Voyages au Portugal aux XVIIIè et XIXè siècles", Pimientos, Lisbonne, 2005, p. 215)
Saint-Pétersbourg – 1795
L’hiver, les appartements [de la noblesse] sont éclairés avec le plus grand luxe. On les parfume avec du vinaigre chaud dans lequel on jette des branches de menthe, ce qui donne une odeur très agréable et très saine.
(Elisabeth Vigée Le Brun, "Souvenirs 1755-1842", Honoré Champion éditeurs, Paris, 2008, p. 540)