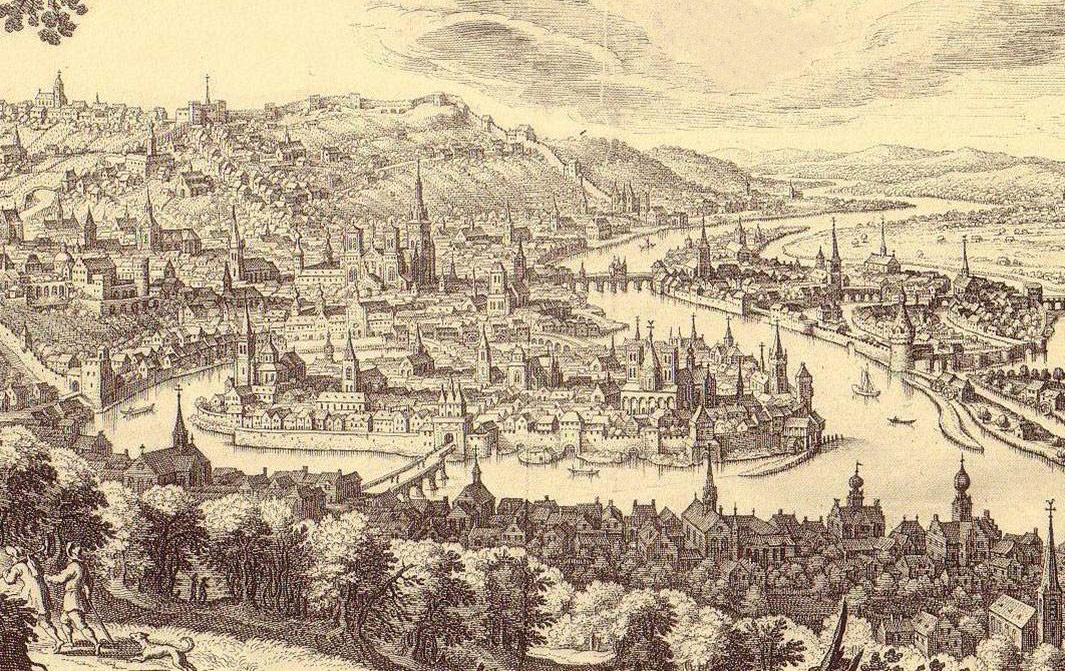l’odeur des villes au XIXè s
Provence, XIXè siècle
Dans des régions comme la Provence, la pauvreté des sols, la relative rareté des excréments animaux, le manque de moyens financiers pour se procurer des engrais artificiels rendaient le fumier précieux. Les rues des villes et des villages étaient parsemées de branches et de feuilles de plantes aromatiques (buis, lavande, romarin, sauge) apportées des montagnes, et qu’on laissait pourrir dans les rues et les passages, en y ajoutant tous les apports naturels humains et animaux. Ainsi y avait-il en permanence des tas de fumier dans chaque rue, dans chaque ruelle, ce qui favorisait la prolifération des rats. Un siècle de lutte menée par les autorités sanitaires et municipales pour changer cet état de choses n’avait pu venir à bout de l’opposition du petit peuple qui n’avait pas d’autres moyens de se procurer de l’engrais pour ses lopins de terre, et naturellement ne connaissaient pas les cabinets. Il fallait longtemps pour que la loi de 1894 sur les égouts porte ses effets. La disparition du tas de fumier familial, combinée avec celle des pourceaux, changea radicalement l’aspect des villes rurales.
Eugen Weber, "La fin des terroirs – La modernisation de la France rurale 1870-1914", Fayard/Editions Recherches, Paris, 1983)
Lisbonne, le 20 août 1800
Pendant l'été, presque tous les après-midi, un vent du nord assez frais se lève et ne s'arrête que la nuit; mais cette année il n'y en a pas et le vent souffle rarement. L'inconvénient que représentent les immondices dans les rues, qu'un soleil ardent transforme en fine poussière, se fait sentir maintenant plus que jamais. A peine ouvre-t-on une fenêtre que toute la maison, jusqu'aux derniers étages, se trouvent instantanément couverte de poussière car les voitures qui passent dans les rues en soulèvent toujours d'épais tourbillons. Je ne comprends pas comment des personnes de la bonne société peuvent passer dans les rues sans faire attention à cette saleté, sans même remarquer l'odeur répugnante qui s'en exhale bien souvent.
(Carl Israel Ruders, "Voyage au Portugal, 1798-1802", in: "Voyages au Portugal aux XVIIIè et XIXè siècles", Pimientos, Lisbonne, 2005, p. 260)
Lisbonne, 23 décembre 1800
J'ai beau y penser, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Portugais semblent n'attacher qu'une faible, ou même pas du tout d'importance aux odeurs insupportables dont les voyageurs se plaignent si fréquemment. Il faut croire que l'odorat, chez eux, est un sens moins délicat que chez les autres hommes. Peur-être aussi l'habitude contractée dès la tendre enfance, leur rend-elle ces odeurs moins désagréables qu'à nous. Les eaux sales qu'on jette par les fenêtres à la tombée de la nuit remplissent toute la rue, pendant quelques minutes, d'une vapeur suffocante. Des petits vestibules qui se trouvent à l'intérieur des appartements et où l'on range tous les détritus, vient une puanteur qui pénètre dans la cuisine et qui, parfois, empeste toute la maison. En été, sur les quais où accostent les barques de pêche, le poisson pourri s'accumule. Même au spectacle l'odeur répugnante des lieux d'aisance se répand dans les corridors et parfois arrive à atteindre les loges. il n'set pas rare d'entendre des étrangers pester contre cela mais les Portugais semblent tout à fait indifférents, et, en tout cas, ne font rien pour y porter remède. L'unique chose qu'ils ne supportent pas, c'est l'odeur du tabac. Les dames montrent toujours leur désapprobation et ferment leurs fenêtres avec grand fracas si quelque marin ou si quelqu'un de basse condition passe dans la rue en fumant, alors même que l'arôme du bon tabac brésilien est utile pour dissiper d'autres exhalaisons désagréables. Personne ne fume au Portugal, excepté le menu peuple qui se sert, à cet effet, de rognures de tabac enveloppées dans de petites bandes de papier qu'ils allument. Seuls les étrangers fument la pipe en terre ou en écume, au grand étonnement de chacun.
(Carl Israël Ruders, "Voyage au Portugal, 1798-1802", in: "Voyages au Portugal aux XVIIIè et XIXè siècles", Pimientos, Lisbonne, 2005, pp. 262-263.)
Lisbonne, le 1 novembre 1801
Actuellement, la plupart des rues ne sont jamais balayées, et les autres ne le sont que rarement. Dans celles qui sont balayées, les ordures forment des monticules, mais elles y restent si longtemps qu'elles se répandent à nouveau, avant qu'on en enlève une partie. C'est sans doute de fort mauvais goût de montrer à vos yeux, mon ami, le tableau répugnant d'une rue qui n'a jamais été nettoyée. Mais comment serait ce tableau si vous saviez que, sans commettre d'infraction, on jette par les fenêtres, et des meilleures maisons encore; le matin toutes les balayures; à l'heure du dîner, tous les restes; et le soir, toutes les immondices qui se sont accumulées !
[...] Le soir, le menu peuple fait ses besoins en pleine rue et le jour, sous les porches ou dans les terrains en construction. Je connais des maisons où on ne peut mettre le nez à la fenêtre sans apercevoir quelqu'un sur le point de se soulager, car en ville il n'y a pas de latrines publiques.
(Carl Israel Ruders, "Voyage au Portugal, 1798-1802", in: "Voyages au Portugal aux XVIIIè et XIXè siècles", Pimientos, Lisbonne, 2005, p. 264)
Lezoux - 1801
Arrêté pris par les Maire et adjoints concernant les rues et fontaines.
Du 14 nivôse [de l'an IX (4 janvier 1801)] les Maire et adjoints réunis prenant en considération la propreté des rues de la commune de Lezoux ainsy que des fontaines, objet qui a une si grande influence sur la salubrité de l'air arrêtent ce qui suit
1er
Il est défendu à tous citoyens décarter de la paille sur les pavés devant leur porte pour faire du fumier, et dacumuler des fumiers dans les ruës sous peine d'être punis conformément aux lois
art 2
Il est défendu à tous citoyens de laver des tripes du linge et autres objets dans les bacs des fontaines. Les contrevenants seront punis conformément à la loi
art 3
Le présent arrêté sera rendu public par la voie de l'affiche et publication au son du tambour Duchasseint, maire
(Source : AD63 Série D Administration générale de la commune de Lezoux (commune 63190) :
1 MI 561/6 Texte déposé par Michèle Chadelas Source:http://perso.orange.fr/j.marchanl/anecdotes/quot63.html)
Cuges (35 km de Marseilles) 8 avril 1804
Nous y passâmes la nuit. Dans cette région pousse beaucoup d'herbes aromatiques et du romarin en si grande quantité qu'on ne brûle rien d'autre. Un tel feu de romarin répand une odeur agréable dans la pièce.
(Arthur Schopenhauer, Journal de voyage, Mercure de France - le temps retrouvé, 1989, p. 135.)
Londres, les maisons – vers 1810
Les latrines sont dans la cour, et, communiquant avec les conduits ou égouts souterrains qui passent le Iong de chaque rue, elles n'ont jamais besoin d'être vidées; opération qui empoisonne l'air de Paris pendant la nuit, et y produit souvent des effets funestes.
(Simond, "Voyage d'un Français en Angleterre pendant les années 1810 et 1811, 1816", in: Jacques Gury, "Le voyage outre-Manche – anthologie de voyageurs français de Voltaire à Mac Orlan – du XVIIIè au XXè siècle, Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1999, p. 224)
Rome, février 1817
Il règne dans les rues de Rome une odeur de choux pourris.
(Stendhal, "Rome, Naples et Florence", Diane de Selliers Editeur, Paris, 2010, p. 207.)
Tours – 1820
L’air de ce beau séjour [à Chanteloup en Touraine] est tellement bien-faisant que l’on s’y sent tout autre qu’ailleurs. A vrai dire, je suis douée sur ce point d’un instinct peu commun ; je goûte l’air comme les gourmets savourent la bonne chère, et je crois que ma santé tient à ma susceptibilité pour n’en respirer que du pur, autant que la chose m’est possible.
L’instinct dont je viens de parler ne m’a point permis de séjourner longtemps à Tours. Cette ville est très belle ; mais une odeur de latrines vous poursuit dans toutes les rues. Mon auberge, qui pourtant était la meilleure, m’infectait en dépit des herbes odorantes, des vinaigres dont j’ai soin de me munir en voyage, au point que je n’y pus rester que deux jours.
(Elisabeth Vigée Le Brun, "Souvenirs 1755-1842", Honoré Champion éditeurs, Paris, 2008, pp. 758-759)
Lisbonne, juin 1821
Où trouverais-je des mots suffisamment forts pour exprimer le dégoût que j'éprouve lorsque je considère l'aspect de la ville dans son ensemble, en prenant en compte tant l'apparence que les coutumes de certains de ses habitants ! On dirait que toutes les saletés ont été entassées ici ! On suffoque avec tous ces relents de poisson frit, d'huile rance, d'ail, etc. ; à tous les coins de rue les exhalaisons fétides des légumes pourris se mêlent à celles de la nourriture en état de putréfaction et à d'autres "horreurs" qu'il n'est pas possible de mentionner.
(Marianne Baillie, "Lisbon in the years of 1821, 1822 and 1823", in: "Voyages au Portugal aux XVIIIè et XIXè siècles", Pimientos, Lisbonne, 2005, p. 344.)
Rome – 1822
Presque partout les entrées des maisons en servant de lieu de piscines (= urinoirs) et de réceptacles d’ordure repoussent et offensent la vue et l’odorat.
[…] Rome est encore bien en désordre et bien sale à mes yeux, il pue partout.
[…] L’usage d’ensevelir dans les églises existe toujours à Rome. Beaucoup de gens conviennent de l’abus qui y est attaché, mais les choses n’en continuent pas moins. On assure même que dans les vives chaleurs d’été les églises exhalent du pavé une odeur nauséabonde !
(André Jacopssen, "Itinéraires d’un Brugeois en Italie et en Sicile (1821-1823)", Librairie Droz S.A., Genève, 2008, pp. 91, 169, 176)
Suède, 1827
Les maisons suédoises ont un air de propreté et de simplicité qui charme. D'après un usage universel en Suède, et qui, au sein des villes donne l'idée d'une certaine élégance alpestre, le plancher est semé de feuilles de sapin qui exhalent une odeur salubre et douce.
(Jean-Jacques Ampère, "Littératures et voyages. Esquisses du Nord", Didier, Paris, 1853, in : Vincent Fournier, "Le voyage en Scandinavie - anthologie de voyageurs 1627-1914", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 2001, p. 168.)
Lisbonne,1827
Le parfum des vergers plantés d'orangers et de citronniers flottait à l'instar d'un nuage tandis que nous passions devant les jardins des Quintas .
(James Edward Alexander, "Sketches in Portugal during the Civil War of 1834", in : "Lisbonne – histoire, promenades, anthologie & dictionnaire ", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 2013, p. 333.)
Venise – 1834
Pour dormir, il y a un endroit délicieux : c’est le perron de marbre blanc qui descend des jardins du vice-roi au canal. […] Quand le vent de minuit passe sur les tilleuls et en secoue les fleurs sur les eaux ; quand le parfum des géraniums et des girofliers monte par bouffées, comme si la terre exhalait sous le regard de la lune des soupirs embaumés.
[…] De ces milliers d’isolettes dont la lagune est semée, arrivent tous les jours des bateaux remplis de fruits, de fleurs et d’herbages si odorants qu’on en sent la trace parfumée dans la vapeur du matin.
(Georges Sand, "Lettres d’un voyageur", in : Yves Hersant, "Italies – anthologie des voyageurs français aux XVIIIè et XIXè siècles", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1988, pp. 350-351)
Sienne – 14 octobre 1836
Sienne noua a paru horriblement triste après Florence. […] Il fait froid ici, les places sont désertes, les maisons noires, les rues sales et tortueuses, l’herbe croît sur le pavé et des trous noirs en guise de vestibules exhalent de chaque maison une odeur de moisi et de prison.
(E. Viollet le Duc, "Lettres d’Italie 1836-1837 adressées à sa famille", Léonce Laget, Paris, 1971 p. 166)
Grasse – 20 mai 1838
Rues étroites comme dans les villes du littoral de Gênes. La culture ferait croire à chaque moment qu’on est à Sestri ou à Nervi. Mais absence totale d’architecture et de cafés et mauvaise odeur dans les rues, où l’on fait toujours un peu de fumier suivant l’exécrable usage que j’ai déjà trouvé à Aubagne et au Luc. [...] Réellement, je suis poursuivi jusque dans ma chambre par une certaine odeur de résine qui me fait mal à la tête et qui pourrait bien être l’odeur de la parfumerie de Grasse.
(Stendhal, “Voyage dans le midi“, Jean-Jacques Pauvert, Sceaux, 1956, pp. 297 et 298.)
Lausanne - 1839
Il était cinq heures après-midi. Je montais lentement vers la cathédrale par les rues étroites de la ville. L’heure du dîner approchait pour les bourgeois qui se hâtaient de rentrer chez eux. Je voyais par les lucarnes des rez-de-chaussée flamber les âtres des cuisines, et les ménagères et les servantes s’empresser autour des chaudières et des tourne-broches. La fumée débordait par plus d’une fenêtre, et l’odeur
des lèchefrites remplissait les rues.
(Victor Hugo, “France et Belgique, Alpes et Pyrénées”, Nelson, Edit., Paris, s.d., p. 328.)
Lyon – 1844
Quelle cité, Lyon! On parle de gens qui, dans certaines circonstances malheureuses, ont l'impression qu'ils ont dégringolé du haut des nues! Ici c'est toute une ville qui a dégringolé, tant bien que mal, du haut du ciel, après avoir été ramassée, comme d'autres pierres provenant de cette région, dans des marais et lieux désertiques et lugubres à voir! Les deux grandes artères que traversent impétueusement les deux grands fleuves, et toutes les petites rues qui s'appellent légion, étaient torrides, brûlantes, étouffantes. Les maisons, hautes et vastes, extrêmement sales, étaient putrides comme de vieux fromages, et grouillantes d'une population aussi dense. Grimpant partout sur les collines qui enserrent la ville, ces maisons pullulent, et les mites de fromage qui y habitent paressaient à leur fenêtre, faisaient sécher leurs hardes sur des perches, allaient et venaient à l'extérieur en se traînant, sortaient pour haleter et souffler sur le trottoir, se faufilaient au milieu d'énormes tas et balles de marchandises sentant le moisi et le renfermé à en suffoquer; et ils vivaient, ou plutôt ils ne mouraient pas avant que vienne leur heure, dans un cloaque privé d'air. Toutes les villes industrielles fondues en une seule donneraient à peine l'impression que me fit Lyon telle qu'elle se révéla à moi : car tous les caractères que l'absence d'égouts et d'enlèvement des ordures confère à une ville étrangère semblaient greffés, là, sur les misères propres à une ville industrielle; et cela donne des fruits tels que je ferais un détour de plusieurs miles pour éviter de les retrouver sur mon chemin.
(Charles Dickens, "Images d'Italie", traduit de l'anglais par Henriette Bordenave, Avignon, Ed. Barthélemy, 1990, in: Jean M. Goulemot, Paul Lidsky et Didier Masseau, "Le voyage en France – anthologie des voyageurs européens en France, aux XIXè et XXè siècles, Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1997, p. 125)
Paris - 1845
Il n’est personne à Paris qui ne soit tous les jours frappé, dans les spectacles, les promenades et les établissements publics, dans les boutiques et magasins, de l’odeur infecte des gaz d’éclairage.
(extrait du “Rapports du Conseil de salubrité et d’hygiène publique“, in: Jean-Pierre Williot, “Le gaz à Paris au XIXè siècle: écoulements putrides et mauvaises odeurs”, in: “Géographie des odeurs” (sous la dir. de Robert Dulau et Jean-Robert Pitte), l’Harmattan, coll. Géographie et cultures, Paris, 1998, p. 152.)
Oslo (à l'époque Christiania), 1850.
[une chambre lui avait été préparée] On avait semé sur le sol une jonchée de branches de pin et de genévrier, mêlées de feuilles de menthe, tapis odorant qu'on renouvelle chaque jour; au pied du lit une natte d'osier, à larges mailles, toute blanche, et le bord rehaussée d'une légère bande violette d'une nuance très tendre. Cet osier neuf, encore humide de la sève de ses branches, exhale une senteur à la fois pénétrante et douce, qui vous prend d'abord sur les nerfs, et vous fait tout à la fois un peu de mal et beaucoup de plaisir.
(Louis Enault, "La Norvège", Hachette, Paris, 1857, in: Vincent Fournier, "Le voyage en Scandinavie - Anthologie de voyageurs 1627-1914", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 2001, pp.327-328.)
Norvège, sud ouest d'Oslo, 1850
[Dans un chalet] Tout était simple, et je ne remarquais pas la moindre trace de luxe inutile ; du moins tout était propre : il y avait des vitres aux fenêtres, et comme chez tous les paysans, des feuillées de bouleau et des branchées de sapin sur le parquet.
((Louis Enault, "La Norvège", Hachette, Paris, 1857, in: Vincent Fournier, "Le voyage en Scandinavie - Anthologie de voyageurs 1627-1914", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 2001, p. 357.)
Lyon - XIXè siècle
L’industrie parsème la ville entière d’une multitude d’établissements qui se livrent, sans aucune précaution, à leurs activités, au coeur même des habitations, qu’elles rendent, à nos yeux, difficilement habitables par leurs fumées, leurs odeurs et leurs résidus. Parmi eux, les établissements qui travaillent les matières animales semblent les plus nombreux et les plus souvent énoncés. On aurait quelques difficultés à recenser le nombre de tueries, d’abattoirs particuliers qui parsèment les cours des immeubles et les arrière-boutiques des tripiers, bouchers, charcutiers et autres professions de la viande. La plupart du temps, les animaux pénètrent dans la cour par l’allée qui conduit aussi les habitants de l’immeuble à leur logement. Ils sont ensuite égorgés et dépecés à même la cour, le sang et les viscères étant évacués à ciel ouvert par les caniveaux ou déposés à même la rue. Les odeurs, les cris, la contamination des eaux, la présence des insectes, celle des chiens, toutes les causes d’insalubrité se retrouvent dans ce genre d’établissement.
Dans le sillage des tueries, et parfois même dans les mêmes locaux, on trouve aussi dispersés les dépôts d’os, de cuirs verts et de peaux fraîches dont les odeurs affreuses ou insupportables obligent les voisins à fuir leur domicile ou à vivre barricadés, sans forcément pouvoir se protéger des émanations nocives. Les fonderies de suif ne sont pas moins redoutables avec leurs odeurs insalubres et désagréables. Leurs exhalaisons qui menacent la santé des habitants corrompent la végétation et infectent des denrées alimentaires détenues dans les greniers alentours, sans compter le rejet des eaux fétides dans des excavations temporairement sans drainage. Avec à peu près les mêmes effets, les fabriques de colle ou de gélatine qui utilisent les ossements des animaux.
Parmi les établissements les plus fréquents, les fours à chaux sont les plus contestés. Une partie des campagnards, pourtant contents de trouver des amendements à bon marché, leur voue une haine sévère, car ils les accusent de gâter leurs récoltes et, en particulier, de dénaturer le vin. Nocive ou non, la fumée des fours à chaux est, de toute évidence, massive et suscite l’ire des premiers villégiateurs des environs de Lyon. Chassés des campagnes et des premières banlieues résidentielles, les fours à chaux sont encore présents dans les villes. On en trouve un, en 1818, rue Vaubecour, à deux pas de la Place Bellecour, mais il en existe encore à Vaise en 1857 et à la Guillotière en 1882, au grand dam des promeneurs et des habitants.
Les premières industries chimiques sont, sans doute, encore plus nocives que les établissements précédents. La fabrication de l’orseille (colorant rouge vif) est l’une des plus nauséabonde, puisqu’il faut laisser fermenter la matière première (un lichen) dans l’urine humaine. Outre les odeurs plus que désagréables; les vapeurs irritent la gorge, titillent le larynx et provoquent la toux. Mais la fabrication de l’eau de Javelle (comme on l’écrit à l’époque), celle de l’acide muriatique, du vitriol, de l’amidon, répandent des émanations suffocantes, qui mettent le voisinage à deux doigts de l’asphyxie, font périr la végétation et altèrent les fabrications de l’industrie textile. Au fur et à mesure que s’affirme la vocation chimique de la ville, on voit se multiplier les fabriques de sulfure de carbone, de soude, d’acide sulfurique, toutes aussi nocives.
La métallurgie est aussi grande pourvoyeuse de nuisances. Outre le bruit qu’elles répandent fréquemment, les fonderies au creuset, les ateliers de dérochage, les fabriques de bijoux factices utilisent à profusion des acides qui répandent odeurs et maux de tête.
On ne saurait conclure ce bref panorama olfactif, sans faire référence aux dépôts de boues et immondices et aux industries qui en font usage. Dans les années 1880, il existe à la Vitriolerie (rive gauche du Rhône, à la hauteur du confluent) au moins trois dépôts de matières fécales dont les émanations se répandent jusqu’aux coteaux de la Mulatière et de sainte Foy, peuplés de résidences estivales, dont les propriétaires protestent vigoureusement. [...]
Certes, toute cette littérature est unilatérale, suspecte, et ne recense que les établissements insalubres, au risque de pousser au noir le tableau et d’exagérer l’ambiance enfumée et infecte de la ville. Il n’empêche que la plupart des industries se signalent d’abord par les odeurs et les fumées qu’elles répandent. Ainsi, l’apparente insensibilité au bruit et la forte polarisation sur les odeurs ne pourraient que refléter l’état réel de l’industrie et non une insensibilité particulière.
(Olivier Balaÿ et Olivier Faure, ”Lyon au XIXème siècle, l’environnement sonore et la ville”, rapport de recherche n°24, mars 1992, CRESSON (centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’Environnement Urbain), Ecole d’Architecture, Grenoble, pp. 22-24.)
Florence - janvier 1856
Ville, où les trois quarts des rues sentent mauvais, [...] où il fait une humidité puante.
(Edmond et Jules de Goncourt, "L'Italie d'hier", Editions Complexes, Paris, 1991, p. 73)
Londres - La Tamise 1852
Ce fleuve infernal aux eaux bourbeuses et fétides. […] Figurez-vous une rivière qui, à marée basse, a pour rives deux nappes immenses de boue nauséabonde. Chaque été, ces plages mortelles propagent l'épidémie aux alentours. Impossible de rester sur le pont du bateau sans avoir constamment un flacon de sels sous les narines. L'aspect du fleuve est ignoble. On frémit à l'idée de faire naufrage dans ces eaux pestilentielles où pas un poisson ne peut vivre. Et qu'on n'élève là-dessus aucun doute. Non seulement les poisons meurent dans cette rivière infecte, mais à chaque instant les matelots et les ouvriers qui travaillent sur les bords tombant asphyxiés et ne se relèvent plus. La Tamise est une calamité publique.
(Eugène de Mirecourt, "Nos voisins les Anglais", 1862, in: Jacques Gury, "Le voyage outre-Manche – antho-logie de voyageurs français de Voltaire à Mac Orlan – du XVIIIè au XXè siècle, Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1999, p. 134)
Londres - 1858
A Londres, toutes les eaux usées et les égouts se jetaient traditionnellement dans la Tamise. L'accroissement de la population au XIXè siècle avait rendu cette situation préoccupante à tel point que scientifiques se penchèrent sur la question. Ils prédirent un avenir épouvantable.
Les choses atteignirent leur paroxysme durant le long été chaud de 1858 quand toutes les rejets commencèrent à se décomposer le long des flancs boueux de la Tamise, au pied même du Parlement. (Things become to a head through the long hot summer of 1858 when all the sewage became to decompose along the sloping mud banks of the Thames.)
Les parlementaires très fiers de leur nouveau Parlement remarquèrent qu'il y était très difficile d'y respirer tant l'odeur était dégoûtante. Ils sertirent toutes les fenêtres du bâtiment pour arrêter les odeurs, mais rien n'y fit. Ils étaient ″nasalement torturés″.
Ils ont même envisagé de déserter the House of Parlement pour se réunir ailleurs. Suite de quoi, l'effroyable odeur n'était pas seulement une histoire horrible, mais devint un enjeu national.
Ils débattirent de la grande puanteur et décidèrent de consacrer 3 millions de Livres à une des constructions les plus importantes de l'époque victorienne: le réseau d'égout de Londres. 14 années ont été nécessaires pour construire les 82 miles de longueur de ce réseau terminé en 1873.
("What the Victorians did for us" présenté par Adam Hart-Davis, BBC 2, 6 février 2003) (trad. M.C.)
Bruxelles - 1864
On dit que chaque ville, chaque pays a son odeur. Paris, dit-on, sent ou sentait le choux aigre. Le Cap sent le mouton. [...] La Russie sent le cuir. Lyon sent le charbon. L’Orient, en général sent le musc et la charogne. Bruxelles sent le savon noir. Les chambres d’hôtel sentent le savon noir - avec lequel elles ont été lavées. Les lits sentent le savon noir - ce qui engendre l’insomnie pendant les premiers jours. Les serviettes sentent le savon noir. Les trottoirs sentent le savon noir.
(Charles Baudelaire: “Pauvre Belgique”, éd. Louis Conard, Paris, 1953, pp. 12-13.)
Douai – 1864
La place est large, aérée, propre, sans poussière ni tumulte, ni mauvaise odeur. Ah ! comme on se repose de Paris !
(Hippolyte Taine, "Carnets de voyage – notes sur la province 1863-65", Librairie Hachette et Cie, Paris, 1913, pp. 155-156)
Montpellier - 1864
De grandes bâtisses aveugles, presque sans jours, grisâtres, salies par le temps et roussies par le soleil; souvent, au sommet, une sorte de tour comme en Italie. Des rues étroites ou plutôt des ruelles pavées de cailloux pointus, de morceaux de pierres anguleuses, âpres, tranchantes, qui blessent les pieds; de petits fumiers, des restes de fruits et de légumes au milieu des rues, des enfants sales, au museau barbouillé de vieille crasse; les plus grandes maisons inhospitalières d'aspect, fermées sur le dehors et silencieuses comme des cloîtres.
(Hippolyte Taine, "Carnets de voyage – notes sur la province 1863-65", Librairie Hachette et Cie, Paris, 1913, pp. 192-193)
Civita-Vecchia - 1864
On entre dans la ville: une triste ville, mélange de ruelles infectes et de bâtiments administratifs qui ont la platitude et la correction de l'emploi. Quelques unes de ces ruelles ont cinq pieds de large, et les maisons s'appuient les unes sur les autres par des contre forts mis en travers. Le soleil n'y arrive jamais ; la boue est gluante. Parfois l'entrée est une vieille bâtisse du moyen âge avec un porche et des sortes de créneaux. On entre avec hésitation dans ce boyau, et des deux côtés apparaissent des bouges noirs où des enfants crasseux, de petites filles ébouriffées enfilent leurs bas et tâchent de rattacher ensemble leurs haillons. Jamais une éponge n'a passé sur les vitres, ni un balais sur les escaliers ; la saleté humaine les a imprégnés et en suinte; une âcre odeur saumâtre monte aux narines. Plusieurs fenêtres semblent croulantes ; les escaliers disjoints rampent autour des murs lépreux. Dans les rues transversales, parmi la fange, les tronçons de choux et les pelures d'oranges, quelques échoppes plus basses que le pavé entre bâillent leur trou.
(Hippolyte Taine, "Voyage en Italie – tome I Naples et Rome", Librairie de L. Hachette et Cie, Paris, 1866, pp. 11-12)
Naples, février 1864
Dans tout le souterrain du Pausilippe et en général dans tout Naples, on a envie de se bouchez le nez; c'est bien pis en été dit-on. Et cela est universel dans le midi, à Avignon, à Toulon, comme en Italie.
(Hippolyte Taine, "Voyage en Italie", tome 1, Julliard, coll. Littérature, Paris, 1965, p. 52)
Naples – 1864
En général dans tout Naples, on a envie de se boucher le nez.
(Hippolyte Taine, "Voyage en Italie – tome I Naples et Rome", Librairie de L. Hachette et Cie, Paris, 1866, p. 58)
Malines – août 1864
[dans les églises] Odeur prononcée de cire et d'encens, absente de Paris.
(Charles Baudelaire: “Pauvre Belgique”, éd. Louis Conard, Paris, 1953, pp. 187-188. – remarque identique à propos de l'église Sainte-Catherine à Bruxelles: Parfum catholique. Odeur déterminée de cire et d'encens (p. 182).)
Douai – 1864
La place est large, aérée, propre, sans poussière ni tumulte, ni mauvaise odeur. Ah ! comme on se repose de Paris !
(Hippolyte Taine, "Carnets de voyage – notes sur la province 1863-65", Librairie Hachette et Cie, Paris, 1913, pp. 155-156)
Rome, mars 1864
A San-Francesco à Ripa, c'est une décoration intérieure de dorures et de marbre la plus fastueuse et la plus exagérée qu'on puisse voir. [...] Ce qui n'est pas moins frappant, c'est le contraste de l'église et de ses alentours. Au sortir de San-Francisco à Ripa, on se bouche le nez, tant l'odeur de morue est forte.
(Hippolyte Taine, "Voyage en Italie", tome 1, Julliard, coll. Littérature, Paris, 1965, p. 280)
Rome – vers 1865
Les rues de Rome présentent, du reste, bien des sujets d’observation au touriste. Sales au possible, pour la plupart, elles forment, à l’exception du quartier du Corso et de la place d’Espagne, un véritable labyrinthe où l’étranger se retrouve fort difficilement. Une odeur d’huile et de fromage règne partout. Cette odeur provient surtout du grand nombre d’établissements de friture en plein vent.
(Alfred Bruneel, "Notes et souvenirs" (Allemagne, Hongrie, Orient, Italie, Suisse), Eug. Vanderhaegen, Gand, 1869, p. 235, in : Sabina Gola, "Un demi-siècle de relations culturelles entre l’Italie et la Belgique", Institut Belge de Rome, Bruxelles – Brussel – Rome, 1999, p. 287)
Lisbonne, 1866
La promenade publique, un jardin long et étroit au milieu de la ville, est éclairée au gaz, le soir, et on y donne des concerts. Les arbres en fleurs dégagent un parfum pénétrant, donnant l'impression de se trouver chez un marchand d'épices ou chez un confiseur en train de préparer et de servir des glaces à la vanille.
(Hans Christian Andersen, "Oeuvres complètes", in : "Lisbonne – histoire, promenades, anthologie & dictionnaire ", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 2013, p. 344.)
Florence – la Tour de Giotto – 1875
C’est dans ce coin de terre que la moderne Florence a fait sa principale station de fiacres et d’omnibus. Les fiacres, avec leurs litières d’étable, formées par le foin répandu, et leur odeur, où domine celle du fumier de cheval, peuvent encore, à la rigueur, s’accorder davantage avec ce cadre que ne le pourrait la populace ordinaire d’une promenade en vogue, avec ses cigares, ses crachats et l’éclat provoquant de ses prostituées ; mais la station d’omnibus, en face de la tour, empêche qu’on puisse s’arrêter un instant pour regarder les sculptures des côtés est et sud, tandis que le côté nord est outragé par une grille et également presque toujours encombré de décombres.
(John Ruskin, “Les matins à Florence“, (“Mornings in Florence“, publié en 1875) Librairie Renouard - H. Laurens édit., Paris, 1906, pp. 185-186. [ traduit par Eugénie Nypels]
Amsterdam – 1876
Un lacet de rues étroites et de canaux m’a conduit à la Doelen Straat. Le jour finit. La soirée est douce, grise, voilée. De fins brouillards d’été baignent l’extrémité des canaux. Ici, plus encore qu’à Rotterdam, l’air est imprégné de cette bonne odeur de Hollande, qui vous dit où vous êtes et vous fait connaître les tourbières par une sensation subite et originale. (…) Ainsi noyée dans ses buées odorantes, vue à pareille heure, traversée par son centre, peu boueuse, mais humectée par la nuit qui tombe, avec ses ouvriers dans les rues, sa multitude d’enfants sur les perrons, ses boutiquiers devant leurs portes, ses petites maisons criblées de fenêtres, ses bateaux marchands, son port au loin, son luxe tout à fait à l’écart dans les quartiers neufs – Amsterdam est bien ce qu’on imagine quand on ne rêve pas d’une Venise septentrionale.
(Eugène Fromentin, " Les Maîtres d’autrefois", Holbein, Bâle, 1947, in, "Amsterdam", Guides Gallimard, Editions Nouveaux-Loisirs, Paris, 1993, pp. 99-100.)
Port - Maurice – (Porto Maurizio, Ligurie) - 1889
[depuis la mer] Devant nous, sur un cône rocheux, large et haut qui semble sortir des flots et s’appuie contre la côte, grimpe une ville pointue, peinte en rose par les hommes, comme l’horizon par l’aurore victorieuse. Quelques maisons bleues y font des taches charmantes. On dirait le séjour choisi par une princesse des Mille et une nuits. C’est Port-Maurice.
Quand on l’a vue ainsi, il n’y faut point aborder.
J’y suis descendu pourtant. Dedans, une ruine. Les maisons semblent émiettées le long des rues. Tout un côté de la cité, écroulé vers la rive, peut-être à la suite d’un tremblement de terre, étage, du haut en bas du rocher qui les porte, des murs écrêtés et fendus, des moitiés de vieilles demeures plâtreuses, ouvertes au vent du large. Et la peinture si jolie de loin, quand elle s’harmonisait avec le jour naissant, n’est plus sur ces débris, sur ces taudis, qu’un affreux badigeonnage déteint, terni par le soleil et lavé par les pluies.
Et le long des ruelles, couloirs tortueux plein de pierres et de poussière, une odeur flotte, innommable, mais explicable par le pied des murs, si puissante, si tenace, si pénétrante, que je retourne à bord du yacht, les yeux salis et le cœur soulevé. Cette ville est pourtant un chef-lieu de province. On dirait, en mettant le pied sur cette terre italienne, un drapeau de misère.
En face, de l’autre côté du même golfe, Oneglia, très sale aussi, très puante, bien que l’aspect moins sinistrement pauvre et plus vivant.
(Guy de Maupassant, “La vie errante”, Société d’Editions Littéraires et Artistiques, Paris, 1903, pp. 35-36.)
Monreale - Sicile 1889
Le petit cloître de l’église San Giovanni degli Eremiti, une des plus anciennes églises normandes de caractère oriental, bien que moins remarquable de celui de Monreale, est encore bien supérieur à tout ce que je connais de comparable.
En sortant du couvent, on pénètre dans le jardin, d’où l’on domine toute la vallée pleine d’orangers en fleurs. Un souffle continu monte de la forêt embaumée, un souffle qui grise l’esprit et trouble les sens. [...] Cette senteur vous enveloppant soudain, mêlant cette délicate sensation des parfums à la joie artiste de l’esprit, vous jette pendant quelques secondes dans un bien-être de pensée et de corps qui est presque du bonheur.
(Guy de Maupassant, “La vie errante”, Société d’Editions Littéraires et Artistiques, Paris, 1903, pp. 107-108.)
Port - Maurice – (Porto Maurizio, Ligurie) - 1889
[depuis la mer] Devant nous, sur un cône rocheux, large et haut qui semble sortir des flots et s’appuie contre la côte, grimpe une ville pointue, peinte en rose par les hommes, comme l’horizon par l’aurore victorieuse. Quelques maisons bleues y font des taches charmantes. On dirait le séjour choisi par une princesse des Mille et une nuits. C’est Port-Maurice.
Quand on l’a vue ainsi, il n’y faut point aborder.
J’’y suis descendu pourtant. Dedans, une ruine. Les maisons semblent émiettées le long des rues. Tout un côté de la cité, écroulé vers la rive, peut-être à la suite d’un tremblement de terre, étage, du haut en bas du rocher qui les porte, des murs écrêtés et fendus, des moitiés de vieilles demeures plâtreuses, ouvertes au vent du large. Et la peinture si jolie de loin, quand elle s’harmonisait avec le jour naissant, n’est plus sur ces débris, sur ces taudis, qu’un affreux badigeonnage déteint, terni par le soleil et lavé par les pluies.
Et le long des ruelles, couloirs tortueux plein de pierres et de poussière, une odeur flotte, innommable, mais explicable par le pied des murs, si puissante, si tenace, si pénétrante, que je retourne à bord du yacht, les yeux salis et le cœur soulevé. Cette ville est pourtant un chef-lieu de province. On dirait, en mettant le pied sur cette terre italienne, un drapeau de misère.
En face, de l’autre côté du même golfe, Oneglia, très sale aussi, très puante, bien que l’aspect moins sinistrement pauvre et plus vivant.
(Guy de Maupassant, “La vie errante”, Société d’Editions Littéraires et Artistiques, Paris, 1903, pp. 35-36.)
Prague et en particulier son ghetto - vers 1890
À propos de la synagogue: Dans l’odeur suffocante des lampes à huile, dans l’obscurité, un chantre psalmodiait ... [...]
Le pavé poisseux était encombré de déchets répugnants, de cloaques et de ruisseaux malodorants. Des milliers de rats avaient élu domicile dans ces passages puants. En raison de l’absence d’égouts, on y respirait des relents infectés de miasmes. [...]
Les ruelles du Cinquième Quartier étaient riches en tavernes, bouges et pièges de toutes sortes. Tavernes enfumées, puant la moisissure et la décrépitude, avec leurs clients agglutinés dans un petit espace sous une lampe à huile qui jetait une lueur jaunâtre sur leurs corps enflés. [...]
La puanteur, l’humidité, la saleté nauséabonde, la décrépitude des logements surpeuplés, cause de contagion et de mortalité élevée, la carence des services d’hygiène et d’eau potable, l’étroitesse des rues en mauvais état, à peine aérées et sans soleil, la misère, (...) tout cela conduisit les autorités de Prague à détruire le ghetto.” [en 1893]
(Angelo Maria Ripellino, “Prague magica”, Plon, coll. Terre Hunaine/poche, Paris , 1993, passim.)
Le Havre - vers 1895
La rue est faite pour qu’on y passe, mes enfants, et non pour qu’on y joue. Ne vous attardez jamais dans la rue. Et méfiez-vous de tout. “ Ainsi parlait notre maman qui ne savait pas nous convaincre. Qu'étaient, à nos yeux, les périls de la rue, au prix de ses enchantements?... J’aimais la rue Vercingétorix, la rue du Château, et, si je ressuscite un jour, fantôme aveugle, c’est au nez que je reconnaîtrai la patrie de mon enfance: senteurs d’une fruiterie, fumet de la blanchisserie, bouquet chimique du pharmacien qu’illuminent, dès la chute du jour, une flamme rouge, une flamme verte, noyées toutes deux dans des bocaux ronds, haleine de la boulangerie, noble, tiède, maternelle. J’allais, les narines en éveil.
(Georges Duhamel, “Le notaire du Havre”, Mercure de France, Paris, 1933.)
Tromsö,1897
Mais à peine pris contact avec le sol, [en descendant du bateau qui l'y conduit] qu'une grimace de dégoût s'ébauche sur nos physionomies. Les parfums qui nous montent aux narines ne sont évidemment pas de la même nature que les odeurs de Paris ; ils n'en sont pas moins désagréables, et à défaut de trait de ressemblance plus frappant, il faut confesser que Tromsö peut se prévaloir de celui-là au moins pour aspirer à entrer en parallèle avec la Babylone moderne.
Il est vrai que, pour être juste, il convient d'ajouter immédiatement que les relents de haut goût dont souffre notre odorat ne provient pas, comme ceux qui vicient l'atmosphère de notre capitale, d'une défectuosité dans le service de la voirie. Loin d'être imputable à l'incurie des édiles norvégiens, ils proclament, au contraire, avec une éloquence qui n'admet pas de réplique, l'importance commerciale de la cité. Il vaudrait mieux, pour la satisfaction de nos nerfs olfactifs, que Tromsö fût une vaste usine à fabriquer l'essence de benjoin ou d'opoponax. Les circonstances en ont fait un des grands entrepôts de l'industrie poissonnière : toutes les doléances du monde ne parviendront pas à modifier les conséquences de cette situation.
Aussi bien finit-on à la longue par tellement s'imprégner des émanations qui flottent dans l'air, qu'on en devient insensible. On traverse sans faiblir la rangée des pittoresques maisons de bois d'où elles s'exhalent et dans lesquelles s'empile le produit des grandes pêches annules.
(Antoine Sallès, "Voyage au pays des fjords, Plon, Paris,1898, in: Vincent Fournier, "Le voyage en Scandinavie - Anthologie de voyageurs 1627-1914", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 2001, p. 607.)
Le Venise - mai 1897
La première chose qui frappe l'odorat du voyageur arrivant à Venise, c'est l'absence totale de parfum de crottin de cheval. Cette particularité, assez bizarre en apparence, s'explique d'elle-même dès qu'on s'aperçoit, par la pratique, que les seuls modes de locomotion et de véhiculage à Venise sont le footing et le gondoling.
(Alphone Allais, "à l'œil", Flammarion, Paris, 1921, p. 286)
Gênes – 1899
Si rien n'est plus joli que l'entrée de ce port, rien n'est plus sale que l'entrée de cette ville. Le boulevard du quai est un marais d'ordures, et les rues étroites, originales, enfermées comme des corridors démesurément hautes soulèvent incessamment le cœur par leurs pestilentielles émanations.
(Guy de Maupassant, "La vie errante", Société d'Editions Littéraires et Artistiques, Paris, 1903, p. 45)
Bourgogne – XIXè siècle
Après que les hommes à l'aube aient coupés les branches fleuries des tilleuls, c'étaient les enfants qui, sous la conduite des grands-mères, venaient ramasser les rameaux. Les garçons les traînaient à l'ombre. […] Tout était entassé par places, à l'ombre, et les vierges et les enfants, assis sur l'herbe, "écaillaient" en chantant les fleurs blondes du tilleul et en faisaient des tas énormes sur des draps immaculés. Tout le village était rempli du lourd parfum, un peu envoûtant, de l'arbre sacré. La récolte était telle que tout le monde pouvait y venir puiser à profusion, chacun s'occupant de faire sécher sa portion sous les hangars, sur des claies d'osier ou de liane.
(Henri Vincenot, "la vie quotidienne des paysans bourguignons au temps de Lamartine", Hachette, Paris, 1976, p. 126.)
Paris - fin XIXè - début XXè siècle
La persistance des “odeurs de Paris” prouve toutefois la lenteur de l’évolution des pratiques édilitaires. Jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, et bien que le tout-à-l’égout ait été voté en 1889 et l’aqueduc d’Achères achevé en 1895, la capitale demeure puante en été. [...] De sporadiques campagnes tentent, à l’image de celles que suscite la police des moeurs, de soulever l’opinion contre l’incapacité des édiles. Durant l’été 1911, la crise éclate. L’odeur suffoque le promeneur, surtout le soir; au dire des experts, il s’agit d’une puanteur “de cirage, de matière organique chauffée”. Cette fois, grâce à Verneuil, le coupable se découvre: il s’agit des usines de superphosphates installées dans la banlieue nord. La ceinture laborieuse impose sa puanteur coupable comme naguère l’abominable Montfaucon. L’industrie s’est substituée à l’excrément dans la hiérarchie nauséeuse.
(Alain Corbin, “Le miasme et la jonquille”, Flammarion, coll. Champs, Paris, 1986, pp. 265-266.)